Dix ans après son lancement officiel, le piétonnier du centre-ville de Bruxelles fait désormais partie du paysage quotidien des habitants, des travailleurs et des touristes. Inauguré en 2015, ce vaste projet d’aménagement des boulevards centraux avait pour ambition de redonner l’espace urbain aux piétons, de désengorger le cœur de la capitale et d’offrir un environnement plus respirable, plus calme, plus vert. Une décennie plus tard, la ville a changé. Mais à qui profite vraiment cette transformation ? Et à quel prix social et urbain ?
Un projet urbain d’envergure
Le piétonnier de Bruxelles est né dans un contexte de volonté politique forte, portée par une coalition municipale désireuse de moderniser l’image de la capitale et de répondre aux défis environnementaux pressants. Dès le départ, l’objectif était clair : transformer les boulevards du centre, autrefois dominés par la circulation automobile, en une zone réservée aux mobilités douces et aux usages collectifs.
De la place De Brouckère jusqu’à la Bourse, et progressivement jusqu’à la place Fontainas, les rues ont été rendues aux piétons, aux cyclistes et aux transports en commun. Des travaux importants ont été menés pour reconfigurer l’espace public, supprimer les voiries, installer du mobilier urbain, planter des arbres, créer des espaces de rencontre et favoriser la tenue d’événements culturels ou commerciaux en plein air.
Qualité de vie et environnement : des effets visibles
Sur le plan environnemental, les effets de cette piétonnisation sont mesurables et largement salués. La suppression du trafic automobile dans le centre a permis une réduction significative des nuisances sonores, une amélioration de la qualité de l’air, et une baisse de la congestion. Bruxelles, régulièrement pointée du doigt pour ses embouteillages et ses pics de pollution, a offert un nouveau visage dans son cœur historique : plus calme, plus fluide, plus agréable à vivre.
La transformation a également encouragé l’essor des mobilités douces. Le nombre de cyclistes a fortement augmenté, les piétons sont de plus en plus nombreux, et la redécouverte d’un centre urbain libéré des voitures a favorisé une réappropriation collective de l’espace. Les habitants comme les visiteurs profitent désormais d’une ville plus accueillante, avec des places réaménagées, des animations, des terrasses et des événements réguliers qui rythment les saisons.
Une attractivité touristique renforcée
L’un des effets les plus visibles du piétonnier est sans doute sa contribution à l’attractivité touristique de Bruxelles. Le centre-ville rénové séduit. L’expérience urbaine proposée est en phase avec les attentes des visiteurs : flâner dans un espace dégagé, profiter d’une offre commerciale concentrée, découvrir le patrimoine sans nuisance.
Le secteur touristique a su capitaliser sur cette évolution. De nouveaux hôtels, restaurants, concept stores et espaces culturels ont vu le jour. La fréquentation du centre s’est redressée après la crise du Covid, et les chiffres montrent que les touristes plébiscitent le piétonnier comme lieu de passage et de détente. L’image de Bruxelles en sort renforcée : plus européenne, plus vivante, plus contemporaine.
Un dynamisme économique en demi-teinte
Sur le plan commercial, le bilan est plus contrasté. Le taux de vacance commerciale reste relativement faible dans le centre piétonnier, ce qui indique une certaine vitalité. Mais les commerçants interrogés évoquent des réalités hétérogènes. Si certains secteurs — horeca, retail touristique — ont clairement profité de la nouvelle configuration, d’autres ont souffert de la disparition du trafic de transit, ou de l’accessibilité limitée en voiture.
Le e-commerce, la crise sanitaire et les transformations des modes de consommation rendent difficile l’évaluation de l’impact économique propre au piétonnier. Ce que l’on sait, en revanche, c’est que la nature des commerces a évolué. Moins de services de proximité, davantage d’offres orientées vers les visiteurs de passage. Une mutation qui pose la question de la fonction résidentielle du centre-ville.
Une ville qui se vit… ou qui se visite ?
C’est ici que le débat se tend. Car si le piétonnier est un succès pour l’image de Bruxelles, il soulève des inquiétudes croissantes sur la capacité du centre-ville à rester un lieu de vie pour tous. Les associations telles que l’ARAU ou Inter-Environnement Bruxelles ont dénoncé à plusieurs reprises la « touristification » du cœur de la capitale.
Depuis 2015, la typologie du logement a changé. La spéculation immobilière a transformé une partie du parc résidentiel en appart’hôtels, Airbnb, studios à la rentabilité rapide. Les logements familiaux abordables se font rares. Les jeunes couples, les familles avec enfants, les personnes à revenus modestes ont de plus en plus de mal à se loger dans le centre. Le tissu social s’en trouve appauvri. Moins de liens de voisinage, moins de mixité, plus de rotation.
Ce glissement progressif du centre-ville vers une fonction quasi exclusivement commerciale et touristique alimente un sentiment de dépossession chez une partie des habitants. Bruxelles devient agréable à visiter… mais plus difficile à habiter.
Propreté, sécurité, accessibilité : les zones grises
L’un des grands reproches initiaux faits au piétonnier portait sur la propreté et la sécurité. Les images de mégots, de dégradations, ou d’incivilités nocturnes ont alimenté les critiques. Pourtant, les données les plus récentes ne montrent pas de hausse notable de la criminalité dans la zone piétonne. Le sentiment d’insécurité reste présent chez certains usagers, mais il ne s’appuie pas sur une dynamique structurelle.
Côté propreté, la situation s’est améliorée ces dernières années grâce à des efforts accrus de la ville et à la prise en charge de l’entretien par des services spécifiques. Le problème n’est pas résolu, mais il ne constitue plus un point noir central.
Enfin, la question de l’accessibilité demeure sensible. Si la piétonnisation favorise les mobilités douces, elle complique aussi l’accès pour les personnes âgées, les familles, les personnes à mobilité réduite, ou celles qui dépendent d’un véhicule pour se rendre au centre. Le maillage des transports en commun est dense, mais il ne couvre pas tous les besoins, et les options de stationnement sont limitées et coûteuses. Une réflexion plus fine sur l’accessibilité universelle du centre reste donc nécessaire.
Une transformation assumée mais inégale
Les autorités bruxelloises présentent aujourd’hui le piétonnier comme une réussite emblématique. Et sur de nombreux points, l’argument tient : embellissement de l’espace public, réduction de la pollution, relance de la fréquentation touristique, apaisement du cadre de vie.
Mais il serait réducteur d’ignorer les effets secondaires de cette transformation. Une ville ne se résume pas à ses trottoirs neufs et à ses terrasses bien alignées. Elle est aussi faite de ceux qui y vivent, y travaillent, y élèvent leurs enfants. Or, dans cette reconquête de l’espace urbain par les piétons, certains publics ont été oubliés ou marginalisés.
La gentrification n’est pas un phénomène spontané. Elle est souvent la conséquence de politiques bien réelles, qui favorisent certains usages, certaines clientèles, au détriment d’autres. Et à Bruxelles, le piétonnier a parfois été plus pensé comme une vitrine que comme un projet de société inclusif.
Bruxelles a sans doute gagné un peu de souffle. Elle a perdu en mixité. Elle a conquis l’attention des visiteurs, mais laissé de côté une partie de ses habitants. La ville est devenue plus belle, mais pour qui ?
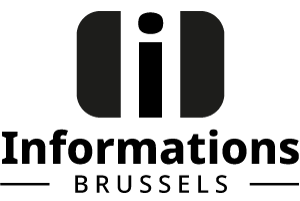






















0 commentaires